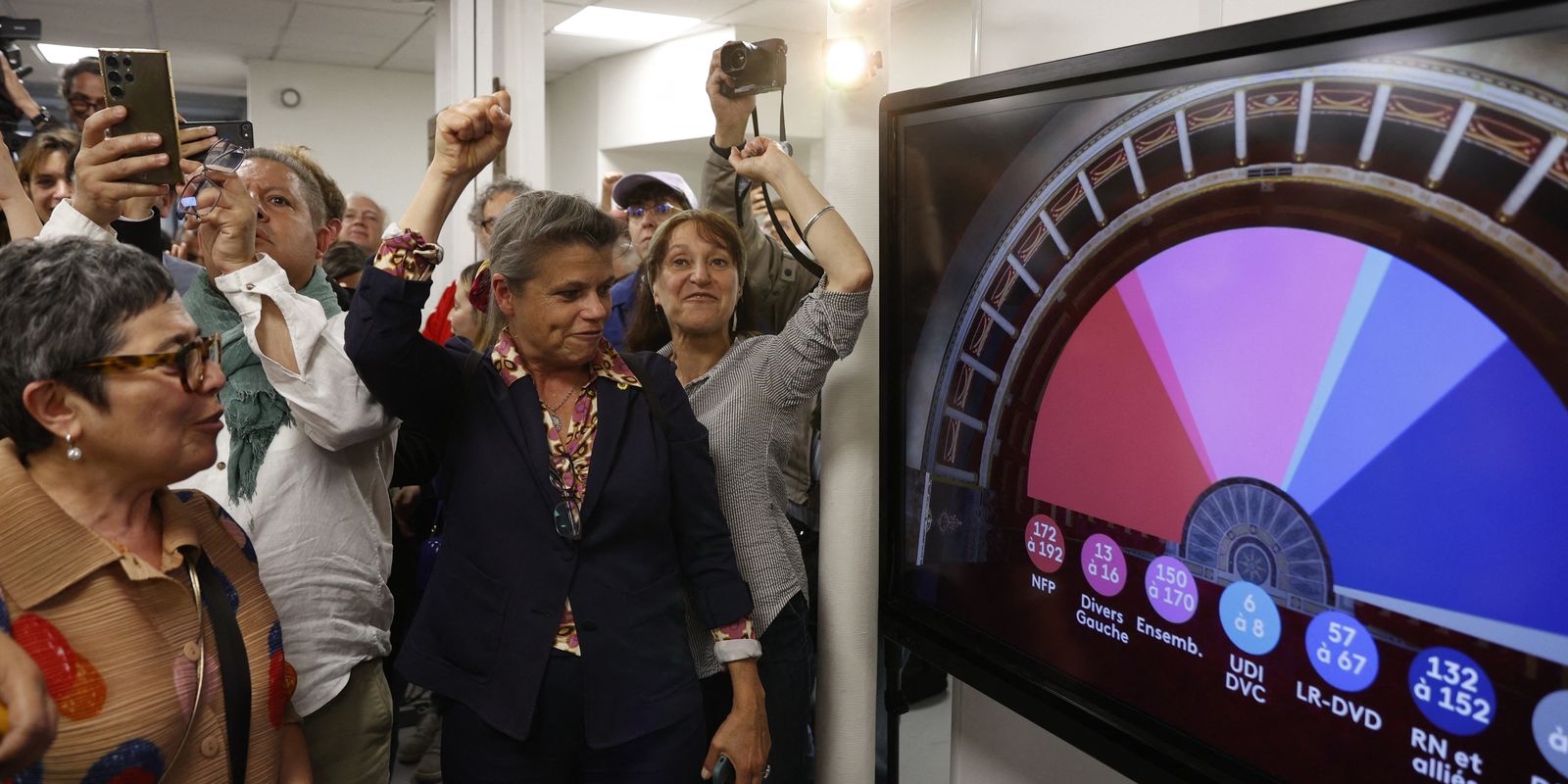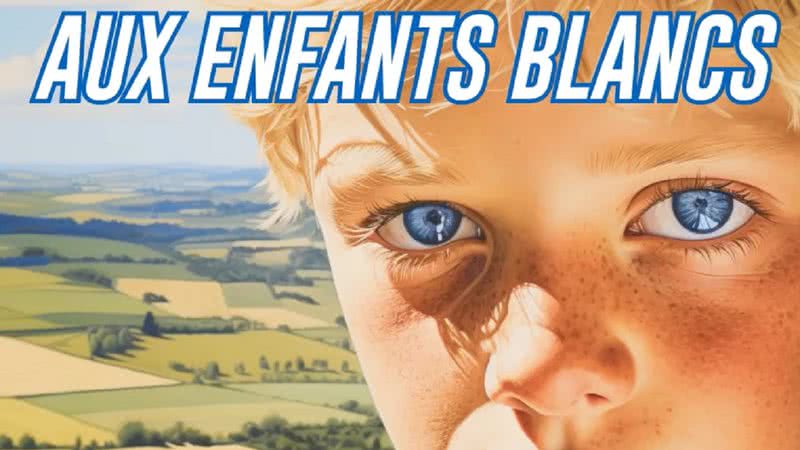Il y a plus de vingt ans, Lélia Wanick Salgado regardait un bout de terre presque stérile au Brésil et rêvait d’y planter une forêt. Elle et son mari ont semé des graines dans le sol pour faire de ce projet une réalité. Aujourd’hui, avec diverses aides, ils ont reboisé une partie de la forêt atlantique. Au milieu de cette forêt est né l’Instituto Terra, une organisation non gouvernementale dédiée à la préservation de l’environnement au Brésil.
C’est l’une des actions qui ont conduit cette année le jury du Prix Gulbenkian pour l’humanité à reconnaître cette Brésilienne qui vit à Paris depuis plus de 50 ans, avec son mari, le photographe brésilien Sebastião Salgado. Dans une interview au Festival Utopia de Braga, Lélia Wanick Salgado soutient qu’il faut « prendre soin de la maison », c’est-à-dire sur la planète Terre.
« Je pense que nous avons tous le devoir de penser sérieusement à notre planète. En fin de compte, la planète peut très bien vivre sans les humains, notre espèce. Mais désormais, nous ne pouvons plus nous passer de la planète. C’est notre maison, donc nous devons en prendre soin, car nous ne pouvons pas vivre sans eau, nous ne pouvons pas vivre sans oxygène. L’eau et l’oxygène sont captés par les arbres », a-t-il souligné.
Selon Lélia Wanick Salgado, face au réchauffement climatique, il est nécessaire d’investir dans la reforestation, et chacun peut et doit faire sa part. « Nous sommes près de neuf milliards d’habitants dans le monde. Si chacun de nous plantait un arbre par an, imaginez à quel point nous aiderions la planète, dit-il.
Mais le prix Gulbenkian va plus loin et interpelle la classe politique. « Nous devons vraiment faire pression sur les politiciens et les maires pour qu’ils plantent des arbres dans les villes, car cela captera tout le CO2 et apportera l’oxygène, l’eau et la pluie dont nous avons besoin. »
Lélia Wanick Salgado déplore les incendies qui ont ravagé la forêt au Portugal et rappelle que « les forêts brûlent parce qu’elles sont en monoculture ». « Lorsque les forêts sont mixtes », dit-il, donnant l’exemple de la forêt atlantique qu’elles ont plantée, « le feu ne pénètre pas aussi facilement ». « Nous avons 400 espèces par hectare », souligne-t-il, expliquant qu’« une espèce s’occupe de l’autre » pour éviter les incendies. « Si on ne plante qu’une seule espèce, une monoculture, le feu va venir tout brûler », prévient Lélia Salgado.
Lélia Wanick Salgado, défenseure de la biodiversité, interrogée sur les manifestations des jeunes en faveur du climat, trouve « formidable que les jeunes prennent vraiment conscience que pour continuer à bien vivre, ils doivent prendre soin de cette planète ». . Cependant, interrogée sur la forme qu’ont prise ces protestations, avec des exemples de jets de peinture sur des tableaux dans des musées ou contre des personnalités politiques, Lélia répond qu’elle n’est pas d’accord.
« Je ne pense vraiment pas que cela mènera à quoi que ce soit », dit-il, expliquant qu’on ne peut pas rejeter la faute sur le passé, citant l’exemple des Portugais à leur arrivée au Brésil. « La première chose qu’ils ont faite a été d’abattre un arbre de la forêt atlantique pour en faire une croix », explique Lélia Salgado, qui conclut que les gens de cette époque n’avaient pas la même conscience qu’aujourd’hui.
Lélia et Sebastião Salgado préparent une exposition vers le 25 avril 1974
Lelia Wanick Salgado est la principale créatrice des expositions et des livres publiés avec le travail photographique de son mari, le photographe Sebastião Salgado. C’est elle qui fait les préparatifs, de la scénographie des expositions jusqu’au montage des albums photos.
Il parle de ce travail d’équipe qui se traduit aussi par le mariage qu’ils vivent. C’est une vie de plus de 60 ans de connexion qui survit car il explique qu’ils ont « les mêmes valeurs, la même vision de la vie ».
Le projet le plus récent auquel ils participent est une exposition sur le 25 avril 1974. À Braga, lors de la séance à la Capela da Imaculada, à Espaço Vita, Lélia Salgado a expliqué qu’entre 1974 et 1976, Sebastião Salgado a représenté des pays tels que comme l’Angola et le Mozambique. Il a également voyagé à travers le Portugal. Ils ont maintenant fouillé les archives pour préparer une exposition qui s’ouvrira au Musée de l’image et du son de São Paulo.
L’exposition n’est pas destinée à voyager au Portugal. Mais Lélia estime qu’il est important de sensibiliser les Brésiliens à cette histoire récente du Portugal, car beaucoup ne connaissent pas la Révolution des œillets. Interrogée par le public sur une autre exposition, « Amazonia », qui a fait le tour du monde, Lélia avoue qu’elle aimerait l’amener au Portugal, mais qu’elle n’a pas encore trouvé de lieu pour la tenir.
Un fils Salgado qui est un cadeau
Sebastião et Lélia ont deux enfants, l’un d’eux est aujourd’hui président de l’Instituto Terra qu’ils ont fondé au Brésil, l’autre, Rodrigo, vit avec eux à Paris. Rodrigo a maintenant presque 50 ans et est atteint du syndrome de Down.
« Personne ne s’attend à un tel enfant », avoue Lélia au moment où elle est devenue émue au cours de la conversation. « Si cela m’est venu, alors c’est à moi. Prenons soin de lui du mieux que nous pouvons. Ce n’est certainement pas facile, mais ce fils nous aide à grandir », dit-il.
« La différence, c’est chaque jour », explique-t-il, ajoutant que Rodrigo lui a apporté « une forme différente de solidarité ». « Il y a eu une bien plus grande solidarité », raconte Lélia Salgado, qui reconnaît qu’il y a eu des moments difficiles, mais que ces épisodes « destinés à presque devenir une catastrophe sont devenus un cadeau ».
Lélia dit fièrement que Rodrigo a un don : c’est un peintre talentueux. Et récemment, en France, une entreprise productrice de champagne qui a racheté une fabrique de vitraux a commandé seize vitraux pour une église qu’elle est en train de rénover. Le travail coloré est déjà en cours.
« Ils ont aimé les dessins de Rodrigo, ils les ont utilisés pour créer les vitraux de 16 fenêtres. Jusqu’à présent, ils en ont fait quatre. Ce sont de grandes fenêtres mesurant huit mètres sur 90, magnifiques ! C’est mon fils », conclut fièrement cette maman de plus de 70 ans, mais qui dégage beaucoup de vivacité.

« Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator. »


:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2024/s/C/GxPO4OQoe7S8YUV0BNUw/ap24238542154052.jpg)